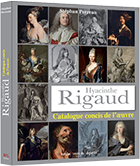P.sup.44
Pierre noire et rehaut de blanc sur papier brun (anciennement bleuté)
H. 38,8 ; L. 30.
Städel Museum, Frankfurt am Main. Inv. 1340.
Inscription au verso (à la plume et en brun) : « Hyacinthe Rigaud »
Sur la feuille de montage, en bas à droite, figure un timbre sec d'une collection française non identifiée du XVIIIe siècle (Lugt 172) ; au verso, à gauche, timbre du Städelsches Kunstinstitut de Francfort-sur-le-Main (Lugt 2356).
Historique :
Ancienne collection de Johann Friedrich Städel (1728-1816) ; donné au musée ; répertorié comme œuvre de Le Vrac Tournières.
Bibliographie :
Stéphan Perreau, « Un Rigaud caché dans les collections du Städel », en ligne, 24 juin 2019, https://hyacinthe-rigaud.over-blog.com/2019/06/quelques-rigaud-caches-dans-les-collections-publiques.html
Descriptif :
Il arrive qu’au détour d’une recherche iconographique, l’œil croise par hasard une autre image que celle qu’il était venu chercher. Ce fut le cas dans le fond des collections graphiques du musée du Städel à Karsruhe dans lequel nous étions venus voir un dessin donné à Robert Le Vrac de Tournières (1667-1752), l’un des collaborateurs d’Hyacinthe Rigaud pour la période 1698-1699 (inv. 1331), et figurant un portrait d'homme en armure. Si l'œuvre, signée dans le bas à la plume « R. Tournière f[ecit] » était datable du tournant du Grand siècle par le port d'une perruque encore peu montante et se révéla tout à fait dans le ton de son auteur, elle suivait dans l’ordre du catalogue une autre feuille, plus ambitieuse et d’une technique plus vive qui, malgré son rattachement au corpus de Tournières, nous sembla davantage appartenir à celui de Rigaud (inv. 1340).
Tourné vers le côté, la tête légèrement vers le spectateur qu’il semble toiser, le modèle pose une main sur ce qui pourrait être un carton à dessin ou un porte document, esquissant, de l’autre, un mouvement de montre vers le dessus d’une table où apparaissent plume, encrier et divers feuillets.
On peut arguer que le piètement du meuble, en balustre à décor floral, constituait un élément récurrent des portraits historiés chez de nombreux portraitistes dans les années 1690-1710, mais le reste du décorum nous sembla beaucoup plus caractéristique encore du vocabulaire du Catalan, de son Philippe V en 1700 jusqu'au Konrad Detlef en 1723 : la présence de la colonne cannelée à droite, lovée par un rideau, répond à la disposition du grand fauteuil, à gauche, simple accessoire destiné à recevoir le fracas du grand manteau volant ; mise en scène exploitée à l'envie par Rigaud. Les dimensions de la feuille (H. 38,8 ; L. 30 cm), suivaient également, à quelques millimètres près, celles de tous les portraits de personnages à mi-corps, dessinés par le maître tout au long de sa carrière.
Comme nous l'a aimablement indiqué Martin Sonnabend, conservateur du département des gravures et des dessins avant 1750 du musée allemand, la feuille avait été d'ailleurs primitivement acquise sous le nom de Rigaud par le fondateur du musée, Johann Friedrich Städel (1728-1816), lequel en fit don par la suite à l’institution avec l’ensemble de sa collection. Il fallut attendre 1862, et le premier inventaire des fonds, pour qu’elle prenne le nom de Tournières, probablement (toujours selon Mr Sonnabend), parce que l’équipe muséale de l'époque lui trouva avec raison une technique assez différente de celles des quatre autres feuilles attestées de Rigaud également léguées par Städel : un portrait de jeune abbé (inv. 1066), celui de Nicolas Le Camus (inv. 1069), du sculpteur Martin Desjardins (inv. 1068) et, surtout, de l’extraordinaire Sébastien Bourdon (inv. 1067), pièce délicatement préparée par Rigaud pour la gravure de Laurent Cars, d’après un autoportrait retouché par le Catalan et qu’il avait en sa possession. Martin Sonnabend nous indiqua en outre, qu’en cette seconde partie de XIXe siècle la comparaison d’avec le dessin de Tournières avait peut-être également plaidé pour une telle réattribution. Il convenait toutefois avec nous que les raisons de ce rapprochement étaient devenues bien minces tant la connaissance de l’Œuvre respectif des deux artistes avait évolué.
La juxtaposition de la feuille du Städel avec quelques spécimens de l'art dessiné de Rigaud, montre à notre avis une réelle cohérence dans la mise et les tracés (faisceaux de hachures convergentes, fonçage des ombres et des creux par surcharge de pierre noire, touches nerveuses dans les contours) : de l'homme sur papier bistre ci-dessus (avec ses tracés presque esquissés) à la force expressive du jeune homme à la chaconne dénouée (technique mixte de lavis, de craie blanche en rehauts), en passant par « l'application » du portrait de Colbert de Torcy, réalisé sur papier bleu par Charles Viennot et retouché par Rigaud.
Bien que l’on sache le jeu hasardeux, on se prend vite à vouloir mettre un nom sur ce visage fier, sur lequel on devine quelques repentirs, sur l’arête du nez mais aussi sur la main posée sur le carton à dessin. Compte tenu du style des meubles et, surtout, de la perruque, on suppose que le modèle frappa aux portes de l’artiste dans les années 1705-1710, intervalle durant lequel Rigaud commissionna Charles Viennot et Jean-Baptiste Monmorency pour la reproduction en dessin de ses plus belles productions. D’une valeur d’au moins 6 livres, prix habituel pour une feuille de cette dimension, le dessin pourrait être l’évocation du portrait de Charles Collin des Tourelles, maître de musique (1699), ingénieur du roi (1690) et professeur de mathématiques, œuvre portée à l’année 1708 au crédit de Monmorency.
Son portrait « en grand » (à mi-corps), avec ceux de ses frères, est référencé dans la collection personnelle de l’artiste dès 1715 avant de passer dans les mains du filleul du peintre puis dans la collection du compositeur Bernard de Bury (1720-1785) qui avait épousé en 1744 une de ses nièces.
Bien entendu, les indices manquent pour porter plus loin l’évocation mais l’idée n’en reste pas moins séduisante, à une époque où Hyacinthe Rigaud est en pleine possession de ses moyens et de son vocabulaire…